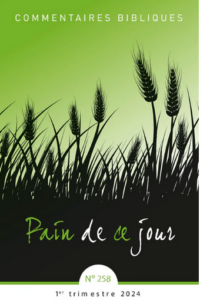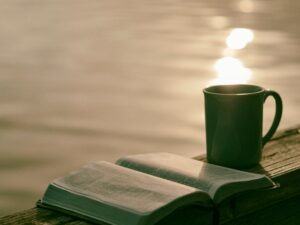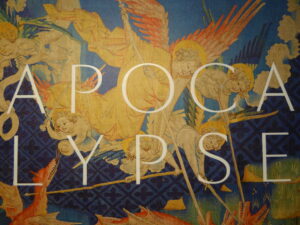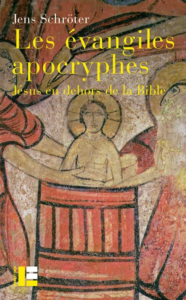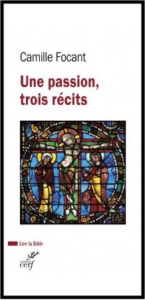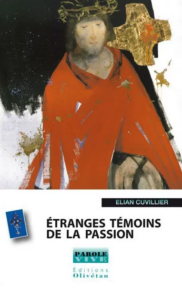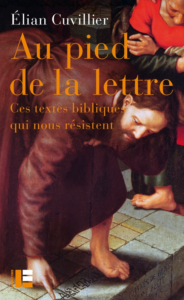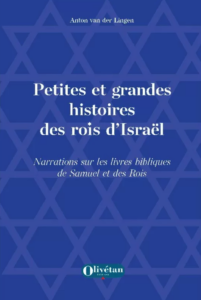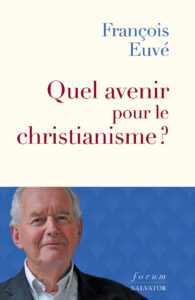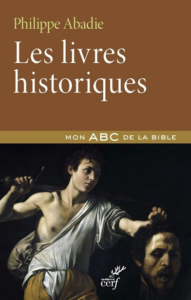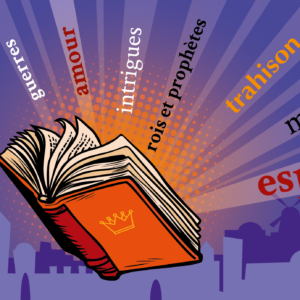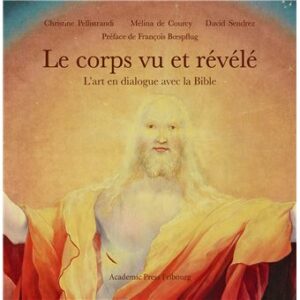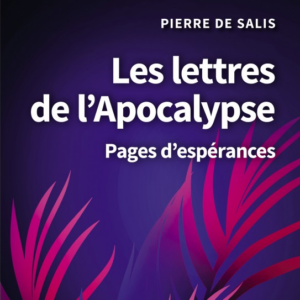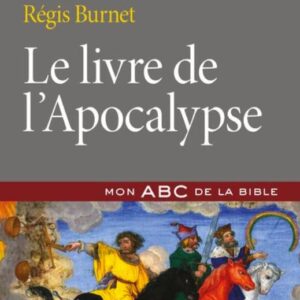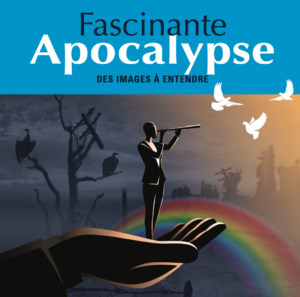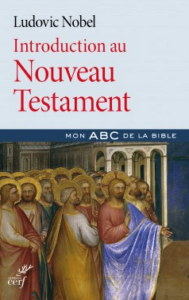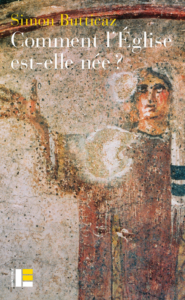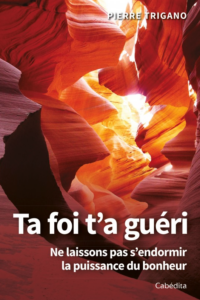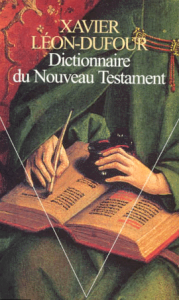Pain de ce jour
Pain de ce jour: brève présentation Connaissez-vous Pain de ce jour ? Il s’agit d’un petit cahier qui propose une pensée biblique pour chaque jour. Ces lectures quotidiennes de la […] Lire la suite
Le cours biblique 2024-2025, présenté par Didier Halter
Didier Halter, pouvez-vous nous présenter en quelques mots le cours biblique 2024-2025 ? La première étude de notre cours biblique 2024-2025 sera disponible dès le 1er novembre prochain. Il s’intitule : […] Lire la suite
Emmanuelle Jacquat, membre de l’équipe du cours biblique
La pasteure Emmanuelle Jacquat travaille actuellement dans la paroisse de Chavornay, dans l’Église réformée évangélique du Canton de Vaud (Suisse). Elle est aussi membre de l’équipe de notre cours biblique, […] Lire la suite
Didier Halter, directeur de l’OPF, un entretien exclusif
Le pasteur Didier Halter dirige l’Office protestant de la formation (OPF) depuis 2011. L’OPF est le service de formation initiale et continue de la Conférence des Églises de Suisse romande. […] Lire la suite
Nicolas Merminod, membre de l’équipe du cours biblique
Le pasteur Nicolas Merminod travaille actuellement dans la paroisse de la Tour de Peilz, dans l’Église réformée évangélique du Canton de Vaud (Suisse). Il est aussi membre de l’équipe de […] Lire la suite
Lire la Bible en 6 ans
Lire la Bible en 6 ans: voilà un défi surprenant. En effet, à l’heure actuelle proposer un objectif du genre « tous les jours pendant 6 ans », cela n’est pas très […] Lire la suite
Que penser de l’Apocalypse?
Que penser de l’Apocalypse? Pourquoi s’y intéresser? Pourquoi l’étudier? Nous avons posé la question à la pasteure Dina Rajohns, qui en effet a mené une série d’études bibliques dans sa […] Lire la suite
Un voyage paroissial à Angers
Dans notre dernière rubrique, la pasteure Dina Rajohns nous a partagé sa passion pour l’étude critique des textes bibliques. Dans sa paroisse (Granges-Marnand, Église évangélique réformée du Canton de Vaud, […] Lire la suite
Dina Rajohns, une série d’entretiens
Nous allons publier cet été une série de trois entretiens avec la pasteure Dina Rajohns. Cette dernière a en effet développé beaucoup de projets en lien avec l’Apocalypse dans sa […] Lire la suite
Les évangiles apocryphes
Les évangiles apocryphes, en bref Il n’y pas que les quatre évangiles du Nouveau Testament qui nous parlent de la vie de Jésus. D’autres textes existent, en effet. On désigne […] Lire la suite
Dans les coulisses de l’Évangile
Dans les coulisses de l’Evangile, voilà le coup de cœur de Simon Butticaz pour notre blog. Brève préentation. Dans les coulisses de l’Evangile, une passionnante série d’entretiens Ce livre se […] Lire la suite
Bible et sciences humaines
Bible et sciences humaines, un défi permanent La Bible à l’épreuve des sciences humaines tombe à point nommé. En effet, dans notre blog, nous vous proposons régulièrement des outils que […] Lire la suite
Une passion trois récits
Le coup de cœur de Daniel Marguerat pour le temps de Pâques à Pentecôte Une passion, trois récits, un livre stimulant pour le temps de Pâques Une passion, trois récits. […] Lire la suite
Quel avenir pour la formation biblique?
Un nouvel entretien avec Guy Lasserre Comment vois-tu l’avenir de la formation biblique « tout public » à l’étude critique de la Bible ? Je pense que cette formation est indispensable et que […] Lire la suite
Étranges témoins de la Passion
Un stimulant livre d’Elian Cuvillier à relire à Pâques Étranges témoins de la la Passion A Pâques, les Églises chrétiennes font mémoire de la mort en croix puis de la […] Lire la suite
Au pied de la lettre
Au pied de la lettre, une lecture stimulante Au pied de la lettre recèle bien des trésors. Pour son auteur, il s’agit de relire et d’expliquer une série de textes […] Lire la suite
Lire les livres des Rois avec Chat GPT
Pourquoi lire les livres des Rois avec ChatGPT? Nous avons directement demandé à ChatGPT pourquoi lire les livres bibliques des Rois avec ChatGPT. Voilà sa réponse. Pourquoi vaut-il la peine […] Lire la suite
Etudier la Bible avec lire.la-bible.net
Le top 5 des traductions françaises Etudier la Bible avec lire.la-Bible.net, rien de plus facile. En effet, en activant l’onglet « Traductions », le site vous propose son top 5 des versions […] Lire la suite
Petites et grandes histoires des Rois d’Israël
Un livre plein de ressources ! Du Xe au VIe siècle av. J.-C., des récits bibliques nous parlent des rois qui gouvernent Israël. Ils résident à Jérusalem (Royaume de Juda) […] Lire la suite
Prédire l’avenir?
La Bible et les prophètes, tout un programme ! Prédire l’avenir? Voilà ce qui vient spontanément à l’esprit quand on entend le mot prophète. Pourtant, quand on se tourne du […] Lire la suite
Etudier la Bible avec levangile.com
Photo de Gabriel Sollmann sur Unsplash levangile.com : comment s’orienter ? levangile.com et bien d’autres sites internet sont de véritables labyrinthes. Alors, comment s’orienter? A quel niveau descendre? Quelle information […] Lire la suite
Quel avenir pour le Christianisme?
Quel avenir pour le Christianisme? Voici le dernier coup de cœur de Daniel Marguerat pour notre blog. Une bonne idée à mettre sous le sapin ! On doit ce livre […] Lire la suite
Etudier la Bible avec Lexilogos
Etudier la Bible avec lexilogos, cela vaut vraiment la peine ! lexilogos.com fait partie de notre top 3 des sites pour étudier la Bible. Voici un petit vademecum pour s’orienter […] Lire la suite
Entretien avec Ruth Ebach (2e partie)
Voici la deuxième partie de notre entretien avec Ruth Ebach. Elle enseigne l’Ancien Testament à la Faculté de théologie et de sciences des religions de l’Université de Lausanne (Suisse). Si […] Lire la suite
Le top 3 des sites pour étudier la Bible
Le top 3 des sites pour étudier la Bible: tout un programme! Il existe en effet énormément de ressources sur le web pour étudier la Bible. Il y en ainsi […] Lire la suite
Entretien avec Ruth Ebach
Ruth Ebach accompagne cette année l’équipe de préparation de notre nouveau cours biblique dédié aux livres bibliques Rois. Depuis cette année, notre cours sont est gratuit sous format web !). […] Lire la suite
Les livres des Rois, un guide
Se familiariser avec les livres des Rois Voilà un petit livre, du à la plume de Philippe Abadie, fort utile pour découvrir les livres bibliques des Rois. Ces livres font […] Lire la suite
Cours biblique gratuit
Nouveau depuis cette année, notre cours biblique est gratuit sous format web! Pour s’inscrire, rien de plus simple. Il suffit de remplir le formulaire en ligne dans notre site. Cours […] Lire la suite
Lire les livres bibliques des Rois
Les livres bibliques des Rois, notre nouveau cours 2023-2024 Rois et prophètes, amours, intrigues et assassinats, constructions de grands bâtiments, destructions et guerres, miracles et annonces de jugement, joies et […] Lire la suite
Le corps vu et révélé
L’art en dialogue avec la Bible Le corps vu et révélé, un stimulant dialogue entre Bible et art Le corps vu et révélé cherche à répondre à des questions simples […] Lire la suite
Les lettres de l’Apocalypse
Les lettres de l’Apocalypse. Voilà une suggestion de lecture en complétement à notre cours 2022-2023 consacré au livre de l’Apocalypse. Une des grands originalités du livre de l’Apocalypse réside dans […] Lire la suite
Lire l’Apocalypse
Un guide très utile pour lire l’Apocalypse Lire l’Apocalypse n’est pas chose simple. En effet, le dernier livre du Nouveau Testament contient pleins de symboles forts: la vie, la mort, […] Lire la suite
Entretien avec Pierre de Marolles (suite)
Voilà en effet la suite de notre entretien avec Pierre de Marolles. Nous avons publié la première partie dans un article précédent. Pierre de Marolles est un spécialiste du dernier […] Lire la suite
Pierre de Marolles
Un entretien pour présenter notre nouveau cours biblique sur l’Apocalypse En quelques mots, qui êtes-vous, Pierre de Marolles? Je m’appelle Pierre de Marolles. Je suis un frère dominicain (une sorte […] Lire la suite
Le groupe des Dombes
Un nouvel entretien avec Guy Lasserre Le Groupe des Dombes, en bref Le Groupe des Dombes est un groupe œcuménique de recherche et de réflexion. Il réunit en effet une […] Lire la suite
Connaissez-vous PRIXM ?
Une newsletter, drôle, décalée et pleine de ressources Connaissez-vous PRIXM? PRIXM est une newsletter gratuite qui paraît chaque dimanche à 15h. Son contenu touche à toutes sortes de thèmes bibliques. […] Lire la suite
Rencontre avec Simon Butticaz
Simon Butticaz, professeur de Nouveau Testament à l’Université de Lausanne répond à nos questions. Il enseigne à la Faculté de théologie et de sciences des religions. Qui êtes-vous, Simon Butticaz? […] Lire la suite
Etudier l’Apocalypse
Etudier l’Apocalypse ? Notre nouveau cours biblique 2022-2023 portera sur le livre de l’Apocalypse. Intitulé Fascinante Apocalypse il donnera l’occasion d’ouvrir à nouveau le dernier livre du Nouveau Testament. Le […] Lire la suite
Lire les Béatitudes sur YouTube
Les Béatitudes, un des textes bibliques emblématiques de la foi chrétienne, à lire sur YouTube Lire les Béatitudes sur YouTube, y avez-vous déjà pensé? Les Béatitudes est des textes poétiques […] Lire la suite
Une stimulante introduction à l’Ancien Testament
Un manuel fort utile pour entrer dans le vaste monde de l’Ancien Testament A la suite de notre présentation de l’introduction au Nouveau Testament, nous avons le plaisir de vous […] Lire la suite
Une stimulante introduction au Nouveau Testament
Un manuel de travail fort utile La collection Mon ABC de la Bible offre de nombreuses ressources pour étudier la Bible. Celle-ci est en effet édite par les Éditions du […] Lire la suite
Le top 3 de nos cours etudierlabible.ch
En bref, le top 3 de nos cours etudierlabible.ch Le top 3 de nos cours etudierlabible.ch sont, dans l’ordre, « Jésus, une prière décalée » (cours 2018-2019), « Quand le malheur frappe… Job: […] Lire la suite
Entretien avec Guy Lasserre (suite)
Dans ce nouvel entretien, Guy Lasserre souligne combien notre cours biblique a été en effet une ressource importante pour écrire son dernier livre sur les sacrifices dans l’Ancien Testament. Dans […] Lire la suite
Comment l’Eglise est-elle née?
Un livre de Simon Butticaz Pourquoi ce livre? Comment l’Eglise est-elle née ? Il s’agit de mettre en évidence comment les premiers croyants ont appréhendé cette réalité qu’ils ont désignée […] Lire la suite
Entretien avec Guy Lasserre
Auteur du livre « Les sacrifices dans l’Ancien Testament » Guy Lasserre, pasteur et docteur en théologie de l’Église réformée évangélique du Canton de Vaud (Suisse) vient de publier une étude remarquable […] Lire la suite
Ta foi t’a guéri
Le coup de cœur de Daniel Marguerat pour Pâques Ta foi t’a guéri : un livre de Pierre Trigano Pour Daniel Marguerat, le dernier livre de Pierre Trigano « Ta foi […] Lire la suite
A table ! Les repas dans la Bible
Étudier la Bible pendant le carême 😉 Les repas occupent une place centrale dans la Bible. En effet, dans le monde antique, tant gréco-romain que dans le monde juif, les […] Lire la suite
Les sacrifices dans l’Ancien Testament
Un livre de Guy Lasserre Les sacrifices: un des dossiers les plus délicats de l’Ancien Testament S’il est une notion qui signifie l’inévitable écart entre les temps anciens et nous, […] Lire la suite
Éthique ou morale?
L’alternative paraît simple. On préfère l’éthique à la morale. En effet, on définit volontiers la deuxième comme un système de règles à respecter, certes pur le bien de toutes et […] Lire la suite
Comment tenir bon à l’heure actuelle?
Tenir bon, à l’heure actuelle? Comment tenir bon à l’heure actuelle? Cette question, nous sommes nombreuses et nombreux à nous la poser. En effet, les temps que nous traversons sont […] Lire la suite
Lire le Nouveau Testament sans tabous
Vous cherchez un guide pour lire le Nouveau Testament sans tabous. Voilà une belle ressource. En effet, cet ouvrage concis et très accessible vous rendra de grands services. Il aborde […] Lire la suite
« Les femmes de saint Paul »
Le coup de cœur de Daniel Marguerat pour Noël Comme l’année passée à pareille époque, Daniel Marguerat nous présente son coup de cœur pour Noël. Voici donc Les femmes de […] Lire la suite
Théologie(s) de la rétribution
Sous le terme de « théologie de la rétribution » , on désigne un ensemble de discours théologiques qui établissent un rapport de cause à effet entre des comportements humains considérés comme […] Lire la suite
La TOB, 60 ans pour l’unité
Un acte de foi dans la puissance de l’Esprit La TOB 60 ans pour l’unité. La TOB, c’est ainsi plus d’un demi siècle au service de l’œcuménisme. Dans l’histoire des […] Lire la suite
« Rahab la spacieuse »
Le coup de cœur de Daniel Marguerat pour Noël Un coup de cœur spécial de Daniel Marguerat pour Noël A la suite de son premier coup de cœur, Daniel Marguerat […] Lire la suite
Un vade-mecum très utile pour l’exégèse biblique
De quoi s’agit-il, en bref? Ce très utile vade-mecum pour l’exégèse biblique se présente comme une sorte de dictionnaire organisé en plusieurs chapitres: les différents livres de la Bible et […] Lire la suite
Le top 3 des dictionnaires bibliques
Voici notre Top 3 des dictionnaires bibliques. Nous avons le plaisir de vous les recommander pour étudier la Bible. Nous commençons ainsi par le petit Dictionnaire biblique de Bernard Gillièron […] Lire la suite
Les coups de cœur de Daniel Marguerat: « Jésus. L’histoire d’une Parole »
Notre site étudier la Bible a le plaisir de vous présenter une nouvelle chronique, les coups de cœur de Daniel Marguerat. Daniel Marguerat est professeur émérite de Nouveau Testament de […] Lire la suite
Le sens de la souffrance ?
La souffrance: sens ou non-sens? La souffrance, quel sens? Dans le mot « sens », il y a deux dimensions, deux idées, deux élans. D’une part, l’idée de direction (le sens de […] Lire la suite
Une nouvelle traduction de la Bible vient de sortir
Les éditions Salvator ont sorti une nouvelle traduction de la Bible. Celle-ci vient de paraître tout récemment (le 24 septembre 2020). Il s’agit d’une Bible proposant une traduction dite liturgique, […] Lire la suite
Foi chrétienne et souffrance
La foi à l’épreuve de la souffrance Foi chrétienne et souffrance? C’est certainement là un des plus grands défis pour la foi. Dit autrement, comment articuler l’espérance chrétienne avec la […] Lire la suite
Faire tomber les masques?
Faire tomber les masques? A l’heure actuelle, cette question agite beaucoup les esprits. Pour combattre la pandémie, une des mesures-clé est le port du masque dans les espaces publics. Mais […] Lire la suite
Mon ABC de la Bible: le livre de Job
Mon ABC de la Bible, en bref Avec Mon ABC de la Bible, nous avons là une très pratique collection de petits guides pour étudier la Bible, récemment créée par […] Lire la suite
Pauvre comme Job?
D’où vient ce proverbe bien connu? Cette parole est certainement un des proverbes bibliques les plus célèbres parmi le grand public. Il fait en effet complètement partie du langage courant. […] Lire la suite
Avec Job, il y a du job !
Dans la Bible, Job occupe une place très particulière. Cela vaut vraiment la peine de lire et étudier le Livre de Job. Il est loin de nous laisser indifférent. Sa […] Lire la suite
Dieu est-il juste?
Cette redoutable question « Dieu est-il juste? » est certainement une des plus difficiles. Et ceci à tous les niveaux: théologique, philosophique ou spirituel. A cette question est liée celle de la […] Lire la suite
Lire la Bible à la maison en déconfinement
Pour vous permettre de lire la Bible à la maison en déconfinement, nous avons le plaisir de vous offrir un cours gratuit. Il s’agit du cours « Une parole impossible », consacré […] Lire la suite
Prier en quarantaine à la maison
Prier chez soi en quarantaine En ces temps de pandémie, la consigne est de rester à domicile. Du coup, nous avons beaucoup de temps pour penser à ce qui se […] Lire la suite
Lire la Bible en quarantaine à la maison
En 2020, un carême pas comme les autres ! Les Églises, en Suisse et ailleurs, se mobilisent elles aussi face à la crise sanitaire mondiale provoquée par l’épidémie de coronavirus. […] Lire la suite
Le Nouveau Testament, en bref
Dans une séquence vidéo, Céline Rohmer explique ce qu’est le Nouveau Testament, ceci en peu plus de 10 minutes. Cela vaut la peine d’y jeter un œil ! Elle présente […] Lire la suite
Découvrir le grec biblique
Les livres du Nouveau Testament ont été écrit en grec. Ceux de l’Ancien Testament en hébreu. Pour étudier la Bible, il est important de pouvoir retourner aux sources et consulter, […] Lire la suite
Un campus numérique pour étudier la Bible
Connaissez-vous « Campus protestant »? Il existe sur le web de nombreuses ressources numériques. Nous vous avons présenté récemment des ressources insoupçonnées pour apprendre l’hébreu biblique et lire l’Ancien Testament dans sa […] Lire la suite
Découvrir l’hébreu biblique
Étudier la Bible dans les langues originales Vous cherchez à apprendre l’hébreu et étudier la Bible dans sa langue originale. L’Ancien Testament a été écrit majoritairement en hébreu. Le Nouveau […] Lire la suite
Un trésor à découvrir
Une nouvelle version de la Bible en français courant (NFC) La Bible en français courant est sortie en 1982. Une édition révisée a été publiée en 1997. Une deuxième révision […] Lire la suite
Étudier la Bible dans son contexte historique
Foi et histoire. On oppose volontiers les deux. Pourtant, l’un en va pas sans l’autre. Étudier la Bible dans son milieu historique évite bien des méprises dans l’interprétation des textes. […] Lire la suite
La Bible et la violence
Un sujet délicat De nombreuses guerres sont désignées comme « guerres de religion ». Cela revient-il à imputer tous les casus belli à une doctrine religieuse? Les facteurs à l’origine d’une guerre […] Lire la suite
Glossaire pour étudier la Bible
Martyr Du grec « martus », ce mot a le sens de témoin dans le Nouveau Testament. Ce n’est qu’à partir de la fin du 2ème siècle qu’il désigne une personne qui […] Lire la suite
Une revue pour étudier la Bible, depuis 30 ans
La revue Lire&Dire c’est quoi La revue Lire&Dire a été crée en 1989. Elle souffle cette année sa 30e bougie ! Lire&dire sort 4 numéros par année, comprenant chaque fois […] Lire la suite
Défi: lire la Bible en un an
Lire la Bible en un an, pourquoi pas? Se préparer avant de commencer Pour lire la Bible un an, il vaut la peine de se poser d’abord quelques questions. Combien […] Lire la suite
Pourquoi lire la Bible encore aujourd’hui
Un témoin du patrimoine mondial de l’humanité La culture biblique est en perte de vitesse dans l’univers francophone européen. la cause remonte aux années 1960, marquées par l’augmentation du pouvoir […] Lire la suite
Le top 3 des Bibles d’étude en français
C’est quoi une Bible d’étude ? Une Bible d’étude, c’est une Bible comportant un nombre important d’aides pour l’étude: des notes en bas de page expliquant les notions difficiles et […] Lire la suite
Des outils pour étudier la Bible chaque jour
Il existe des outils très accessibles pour étudier la Bible jour après jour. En français, nous disposons du Nouveau Testament Commenté. Ce volume assez compact contient un commentaire complet de chaque livre du Nouveau Testament. De plus, ce manuel d’études bibliques existe aussi en édition de poche. Lire la suite
La bible c’est un monde
Une interview de Didier Halter, responsable d’ Etudier la Bible Depuis combien de temps êtes vous responsable d’Etudier la Bible ? Cela fait maintenant 3 ans que je suis le […] Lire la suite
ABOR: livres
Rencontre de Jésus ; Paraboles de Jésus ; Miracles de Jésus ; Entrer en Psaumes ; Mort de Jésus ; Jérémie ; Chrétiens en conflit. Epître aux Galates ; Peuples parmi les peuples ; Jacob. Lire la suite
S’inscrire à notre Newsletter
Newsletters sur le Cours Biblique Si vous voulez recevoir notre Newsletter sur les Cours Bibliques par correspondance cliquez ci-dessous: Annuellement, l’opf envoie la lettre […] Lire la suite